Posts Taggés par racisme
Interstellar (2014) : L’homme du passé est l’homme de l’avenir
| 27 novembre 2014 | Posté par Paul Rigouste sous Cinéma, Tous les articles |
Dans un futur proche, la Terre est devenue invivable. Le seul espoir de l’humanité est de trouver une autre planète sur laquelle s’établir. La NASA envoie alors un groupe d’explorateurs mené par Cooper (Matthew McConaughey) pour passer à travers un trou de ver et atteindre ainsi une autre galaxie contenant des planètes potentiellement habitables. Voici […]
Frère des ours (2003) : qui est le monstre ?
| 23 octobre 2014 | Posté par Paul Rigouste sous Films d'animation, Tous les articles |
Cet article inaugure une série d’analyses portant sur les films d’animation qui développent un propos antispéciste. L’antispécisme est la position politique égalitariste qui refuse et combat l’exploitation des animaux par les humain-e-s, ainsi que tous les discours qui légitiment cette exploitation. Comme j’ai essayé de le montrer ailleurs sur ce site, les films d’animation sont […]
« Le Majordome de Lee Daniels », ou l’art d’envelopper les luttes dans un drapeau.
| 12 octobre 2014 | Posté par caerbannog sous Cinéma, Tous les articles |
Le Majordome de Lee Daniels a connu un succès au box office, aidé sans doute par un défilé d’acteurs et actrices qui donne presque le tournis : Forest Whitaker, Oprah Winfrey, David Oyelowo, Yaya Dacosta, Cuba Gooding Jr., Clarence Williams III, Lenny Kravitz, Mariah Carey, Vanessa Redgrave, Jane Fonda, Robbie Williams, John Cusack … […]
Quand les films d’animation occultent les violences masculines intrafamiliales (I) : La Petite Sirène, Aladdin, La Belle et la Bête
| 25 septembre 2014 | Posté par Paul Rigouste sous Films d'animation, Tous les articles |
Je voudrais ici attirer l’attention sur la réapparition, dans un certain nombre de films d’animation récents, d’un discours sur les relations père-fille que je trouve particulièrement dangereux politiquement parce qu’il contribue à mon avis à occulter les violences masculines intrafamiliales (psychologiques, physiques et sexuelles), en particulier celles des pères sur leurs filles (puisque c’est majoritairement […]
« Ma colère », Yannick Noah (2014) : Misère de l’antiracisme
| 21 août 2014 | Posté par Thomas J sous Clips, Tous les articles |
L’album de Yannick Noah intitulé Combats ordinaires est sorti durant la première moitié de l’année 2014. Bien qu’étant apparemment un moindre succès que les précédents albums, cet album a pu obtenir une audience plus qu’honorable1, se hissant même en juin au top des ventes de disques en France. Ce succès relatif est probablement dû en […]
A la rencontre de Forrester, Ecrire pour exister : le trope du « Professeur Sauveur Blanc »
| 27 juillet 2014 | Posté par Arroway sous Cinéma, Tous les articles |
Dans la sphère critique cinématographique anglo-saxonne, le trope du Sauveur Blanc est bien connu : les productions d’Hollywood qui illustrent ce trope consistant à raconter l’histoire d’un-e héroïn-e blanc-he venant au secours d’un groupe minoréi (les noirs, les latinos, les Indiens d’Amérique, les Japonais…) pour le sauver de la pauvreté/esclavage/extermination, sont légionsii. Certains de ces […]
« Je voudrais devenir un homme comme vous » : du Roi Louie à Louis l’Alligator
| 27 mai 2014 | Posté par Paul Rigouste sous Films d'animation, Tous les articles |
Je voudrais ici analyser deux personnages de l’univers Disney : Le Roi Louie du Livre de la jungle (1967) et Louis l’alligator de La Princesse et la grenouille (2009). Outre leur nom, ces deux personnages ont pour points communs d’aimer le jazz, d’être des Noirs, et de vouloir par-dessus tout « devenir des humains ». Il me semble […]
Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? (2014) : le racisme, c’est rigolo
| 16 mai 2014 | Posté par ielshikh sous Cinéma, Tous les articles |
Claude et Marie Verneuil n’ont vraiment pas de chance : trois des quatre filles de ces Français issus d’une vieille famille catholique se sont mariées respectivement un Juif, un Arabe et un Chinois, alors que la quatrième s’apprête à leur présenter Charles, son fiancé ivoirien. Pour ces provinciaux racistes, la pilule ne passe pas. Alors, pour […]
Sherlock 2.0 : Les adaptations récentes de Sherlock Holmes
| 13 mai 2014 | Posté par Julie G. sous Cinéma, Séries, Tous les articles |
Ces dernières années, nous avons assisté à une déferlante d’adaptations de l’œuvre de Conan Doyle, plus ou moins fidèles au canon,[1] et plus ou moins sympathiques politiquement parlant. Cet article se propose d’étudier les implications politiques des diverses adaptations récentes de Sherlock Holmes. NB 1 : Cet article se focalisera uniquement sur les adaptations modernes […]
La vie rêvée de Walter Mitty (2013) : Ben Stiller reprend du poil de la bête
| 25 avril 2014 | Posté par Paul Rigouste sous Cinéma, Tous les articles |
La vie rêvée de Walter Mitty (The Secret Life of Walter Mitty en anglais) raconte l’histoire d’un employé de bureau travaillant depuis de nombreuses années pour le magazine Life en tant que responsable des archives photographiques. Profondément timide et introverti, il arrive souvent à Walter d’être sujet à des « absences ». Pendant ces moments de rêverie, […]
Jimmy P., Psychothérapie d’un Indien des plaines (2013) : guérir des femmes entre hommes
| 1 avril 2014 | Posté par Paul Rigouste sous Cinéma, Tous les articles |
Jimmy a des gros soucis. Depuis qu’il est revenu de la guerre, tout se détraque dans sa tête : ouïe défectueuse, migraines, et crises imprévisibles où il est aveuglé par des tâches de lumières et respire très difficilement. Sa sœur, chez qui il vit et qui s’occupe de lui, l’amène à l’Hôpital de Topeka où plein […]
Oblivion (2013) : Tom Cruise et ses drones de dames
| 4 mars 2014 | Posté par Paul Rigouste sous Cinéma, Tous les articles |
Comme à son habitude, la critique française autorisée a totalement ignoré la dimension politique de ce blockbuster sorti l’an dernier sur nos écrans. Télérama n’y voit qu’un « gloubiboulga d’action comme les autres » puisque, de toute façon, « une superproduction avec Tom Cruise ne doit pas être un film de SF original »[1]. De leur côté, Libération […]
12 Years a Slave (2014) : l’esclavage à travers les yeux d’un héros hors norme
| 14 février 2014 | Posté par Arroway sous Cinéma, Tous les articles |
Solomon Northup, le héros noir de 12 Years a Slave est un être d’exception. Lorsque Steve McQueen était en quête d’une histoire à raconter, c’est bien ce qui semble l’avoir séduit : « I really wanted to tell a story about that time and place and the slave era in America but I wanted to have a […]
Deathproof (2007) & Django Unchained (2012) : Tarantino, ou le Boulevard du mépris
| 6 janvier 2014 | Posté par Paul Rigouste sous Cinéma, Tous les articles |
Je me concentrerai ici sur une dimension du cinéma de Tarantino, à savoir sa tendance à exploiter des cultures minoritaires en les déconnectant de leur ancrage politique. Cette pratique me semble éminemment critiquable dans la mesure où le réalisateur ne se contente pas seulement de dépolitiser des mouvements contestataires pour n’en garder qu’une coquille vide, […]
Atlantide, l’empire perdu, retrouvé et sauvé par l’homme blanc
| 2 janvier 2014 | Posté par Julie G. sous Films d'animation, Tous les articles |
Sorti en 2001, Atlantide, l’Empire Perdu est un film des studio Disney inspiré officiellement par l’univers de Jules Verne et beaucoup moins officiellement par l’animé Nadia, le secret de l’eau bleue, le film d’animation Le château dans le ciel des studios Ghibli et le film Stargate.1 Atlantide, l’Empire Perdu raconte l’histoire de Milo Thatch, un […]
Insaisissables (2013) : Qui est in ? Qui est out ?
| 2 octobre 2013 | Posté par Paul Rigouste sous Cinéma, Tous les articles |
Insaisissables (Now you see me en VO) raconte l’histoire d’un quatuor de magiciens surdoués, les « Quatre Cavaliers », poursuivis par le FBI et Interpol car leurs tours de magie ultra-médiatisés consistent à voler de l’argent aux riches pour le redistribuer au peuple (c’est du moins ce que l’on croit être leur motivation au début). Tout le […]
2012 en affiches : (II) Katniss et Bella parmi les hommes
| 25 août 2013 | Posté par Paul Rigouste sous Cinéma, Films d'animation, Tous les articles |
J’analyserai dans cette deuxième partie (pour lire la première, voir ici) les affiches des 9 films restants : Madagascar 3, L’âge de glace 4, The Amazing Spider-Man, Men in Black 3, Hunger Games, Twilight, chapitre 4 : Révélation, ainsi que des trois grands succès français de l’année (Sur la piste du marsupilami, La vérité si je mens 3, et […]
Moi, moche et méchant 2 : Papa a raison
| 2 juillet 2013 | Posté par Paul Rigouste sous Films d'animation, Tous les articles |
Moi, moche et méchant premier du nom avait montré une vraie volonté de moderniser la “famille” avec une structure monoparentale et un père apprenant à devenir plus doux “plus féminin” sans que ce ne soit montré comme quelque chose de négatif. Le second film, lui, tout en permettant à Gru de garder des qualités féminines, […]
La Petite Sirène (1989) : Disney relit Andersen
| 5 juin 2013 | Posté par Paul Rigouste sous Films d'animation, Tous les articles |
Sorti en 1989, La Petite Sirène est un immense succès pour les studios Disney et inaugure la période que l’on qualifie habituellement de « second âge d’or »[1]. Classique parmi les classiques, ce film est encore massivement visionné aujourd’hui par nos enfants, et mérite donc qu’on s’y arrête un peu. Mon angle d’approche dans cet article consistera […]
Accepted (2006) : pour une autre école
| 16 avril 2013 | Posté par Paul Rigouste sous Cinéma, Tous les articles |
Il n’y a pas si longtemps, Sheila se réjouissait en chanson de la sortie des classes : « La rue est à nous, que la joie vienne. Mais oui, mais oui, l’école est finie ! ». On peut toujours discuter la valeur musicale de ce tube, reste qu’il exprime un sentiment que toute personne étant passée par notre cher […]
Il n’y a pas si longtemps, Sheila se réjouissait en chanson de la sortie des classes : « La rue est à nous, que la joie vienne. Mais oui, mais oui, l’école est finie ! ». On peut toujours discuter la valeur musicale de ce tube, reste qu’il exprime un sentiment que toute personne étant passée par notre cher système éducatif a éprouvé au moins une fois dans sa scolarité, et probablement plus d’une fois. En effet, Sheila n’a sûrement pas été la seule à s’emmerder à l’école. Personnellement, quand je repense à ma scolarité (avec mention particulière pour les années de collège et de lycée), je n’arrive pas à me souvenir de l’écrasante majorité des cours autrement que comme le lieu d’un profond ennui. Il existe évidemment des exceptions, mais reste que l’immense majorité des élèves vit l’école comme une contrainte.
Je ne parle pas ici de l’école comme lieu de socialisation, c’est-à-dire de l’endroit où l’on est content-e de retrouver ses ami-e-s (quand on en a) et de voir autre chose que son quotidien familial. Je parle des moments d’ « éducation » à l’intérieur de l’école, les moments de cours qui sont la raison d’être de l’école telle qu’elle existe aujourd’hui dans notre société.
Avant d’être un lieu où l’on « apprend à penser par soi-même », à acquérir une « culture générale » ou un « esprit critique », l’école est avant tout une source d’ennui et de stress, un endroit où l’on perd son temps, où l’on apprend à se soumettre à l’autorité, à accomplir sans broncher un travail qui nous est imposé d’en haut, etc.
Or cette école, quasiment personne ne la remet en question. Beaucoup la critiquent, mais c’est toujours sur des points de détails : « il y a trop d’élèves par classes », « il n’y a pas assez de moyens », « il faut revoir la formation des profs », « il faut changer les programmes », etc., etc., etc. Mais toutes ces revendications ne sont que des pansements qui ne remettent absolument pas en cause les fondements de notre système éducatif. Qui remet par exemple en cause sérieusement la relation hiérarchique maître/élève ? L’imposition aux élèves de matières qui ne les intéressent pas ? Le système d’évaluation basée sur la notation ? La mise en compétition des élèves ? Le cloisonnement des matières ? etc.
L’inexistence dans le débat public d’une telle remise en question du système éducatif n’a rien de bien étonnant quand on y réfléchit un peu. En effet, les membres des gouvernements (aussi bien de droite que de « gauche ») n’ont aucun intérêt à toucher à ce système (re)producteur d’inégalités : pourquoi des dominant-e-s remettrait-illes en question l’institution légitimant la hiérarchie dont illes profitent ? Et de leur côté, les fonctionnaires de l’Education Nationale ont aussi peu de raison d’être critiques envers leur « employeur » : ne sont-illes pas précisément les privilégié-e-s de ce système qui a fait d’elleux ce qu’ils sont ? ses meilleurs éléments ? A quoi s’ajoute que, pour un-e prof, renoncer à la relation hiérarchique maître/élève reviendrait à renoncer à un pouvoir réel, ce qui n’est jamais très agréable. Et comme son nom l’indique, un fonctionnaire, c’est fait pour fonctionner, pas pour remettre en question ou critiquer en profondeur le système dont il est un des rouages…
De la même manière qu’il n’existe aucun débat public sur les principes fondamentaux de notre système éducatif, il n’existe quasiment pas de films qui questionnent en profondeur ce même système. Sans avoir une connaissance exhaustive de tous les films sur le sujet, j’ai tout de même la forte impression que la majorité d’entre eux ne font que maintenir le statu quo. Même lorsque le portrait qui est fait de l’école est plutôt négatif, aucune alternative possible ne semble se dessiner. En gros, qu’ils y adhèrent ou qu’ils la critiquent, les films sur l’école sont d’accord sur une chose : l’école c’est comme ça et pas autrement. Si bien qu’il devient difficile d’imaginer une autre école, fondée sur d’autres principes.
C’est pour cette raison que j’aimerais attirer l’attention sur le film Accepted (en français Admis à tout prix) sorti en 2006, ignoré en France (patrie de l’« exception culturelle »…) sûrement parce qu’il n’est qu’une comédie populaire américaine pour ados, et donc considéré a priori comme dénué d’intérêt. Or Accepted me semble être au contraire un film assez exceptionnel d’un point de vue politique. En effet, Accepted ne se contente pas de critiquer l’école (ici, plus précisément, l’enseignement supérieur), mais il montre en même temps la voie vers un autre type d’école, plus épanouissante et égalitaire.
Au passage, le seul autre film qui (à ma connaissance) remet en question aussi radicalement les fondements de notre système éducatif en proposant une alternative est le film français L’école buissonnière, sorti en 1949, et qui romance les débuts du pédagogue Célestin Freinet. A l’heure actuelle, en France, la pédagogie Freinet (ainsi que toutes les autres pédagogies « alternatives ») reste complètement marginalisée, tant dans le primaire que dans le secondaire, alors qu’elle a amplement fait ses preuves sur le terrain. Par exemple, alors que le cas de l’Ecole Concorde de Mons en Bareul (59) semblait désespéré (condamnée à la violence et aux « mauvais résultats »), l’inspection académique accepta en 2001 de faire de cette école de milieu populaire le lieu d’une expérimentation pédagogique en la confiant à des enseignants Freinet[1]. Très rapidement, la situation s’est améliorée avec les parents comme avec les élèves, et 10 ans plus tard, « les résultats scolaires, notamment en français, sciences et mathématiques, ont rattrapé puis dépassé ceux des écoles de milieu équivalent, voire plus favorisé »[2]. Les qualités de cette pédagogie sont donc reconnues par l’institution. Si celle-ci refuse d’en étendre la pratique à tout le système éducatif, c’est donc par choix. Choix qui est, bien évidemment, éminemment politique.
Mais je reviens au film Accepted. Celui-ci raconte l’histoire de Bartleby Gaines qui, après avoir été refusé de toutes les universités auxquelles il avait postulé, décide d’en fonder une lui-même avec l’aide de ses ami-e-s pour ne pas décevoir ses parents. Alors que son intention de départ était que de créer une fausse université pour faire illusion, il se retrouve rapidement submergé par une foule d’autres étudiant-e-s refusés comme lui par les autres universités. Il décide alors d’aller jusqu’au bout de son idée en faisant véritablement fonctionner son université.
L’école des exclu-e-s
Un moment clé du film est celui où le projet de Bartleby acquiert une dimension clairement politique. En effet, les motivations du héros étaient au départ très égoïstes : il s’agissait juste de sauver la face devant ses parents en leur faisant croire qu’il avait été accepté dans une université et de pouvoir se la couler douce avec ses copains sans avoir à travailler. Mais lorsque des centaines d’étudiant-e-s débarquent parce qu’illes croient avoir été accepté-e-s dans une véritable université, Bartleby prend conscience que son problème n’est pas individuel, mais bien politique.
Significativement, cette prise de conscience a lieu lorsqu’un « allumé » dans la salle interrompt le monologue de Bartleby (qui s’apprête à révéler la supercherie) pour déclarer : « Quand j’ai été accepté ici, ça a été la première fois où mes parents ont été fiers de moi ». Bartleby le bourgeois égocentré et beau parleur est alors mis en face d’une réalité dont il n’avait visiblement pas conscience : ce système éducatif produit massivement de la souffrance dans la mesure où il exclut systématiquement tout-e-s celleux qui ne sont pas conformes à ses normes.
En réaction à cette intervention inattendue, les autres étudiant-e-s commencent par rire, puis applaudissent. Par ce geste collectif, illes se reconnaissent ainsi comme les victimes de la même injustice et manifestent en quelque sorte une « conscience de classe » naissante (la classe des exclu-e-s du système éducatif). Les attaques de l’oppresseur (les élitistes de l’université prestigieuse d’à côté) n’auront d’ailleurs jamais raison de la solidarité qui nait dans cette scène, puisque tous les étudiants viendront soutenir Bartleby lorsque celui-ci ira plaider devant le tribunal à la fin du film, c’est-à-dire longtemps après l’atomisation du collectif qui suit le démantèlement de l’université.
Cette scène inaugurale est donc à mon avis centrale, car le film y acquiert une dimension clairement politique. Alors qu’au début, il n’était question que du problème de Bartleby et de ses copains, on sort ici d’un tel traitement individualiste puisque le problème de l’exclusion apparaît comme un problème structurel du système éducatif.
Le film synthétise l’idée de cette scène par une blague de Bartleby qui termine son discours en criant « Welcome to South Harmon Institute of Technology ! Welcome to S.H.I.T. ! ».
Cette université est celle des « merdes » (« shit »), de celleux qui ont été exclu-e-s comme des « merdes » du circuit scolaire légitime. Comme le dit Bartleby juste avant, porté par la foule, cette université est celle qui dit « oui » à tout-e-s celleux à qui on a dit « non », et qui accepte chaque individu tel qu’il est, et pas seulement celleux conformes aux normes arbitraires qui régissent l’institution scolaire : « Je sais ce que ça fait d’être refusé, ça craint. C’est horrible de s’entendre dire « non » : « Désolé, vous n’êtes pas assez bon. Vous n’avez pas fait assez de sport, pas assez de tennis. Vos notes ne sont pas assez bonnes. Vous n’entrerez pas ici ». Et bien vous savez quoi, qu’ils aillent se faire voir ! Ne devrions-nous pas tous avoir la chance de s’entendre dire « oui » ? A South Harmon, on vous dit « oui ». On dit « oui » à vos espoirs, on dit « oui » à vos rêves. On dit « oui » à vos défauts. Alors bienvenue ! ».
Au passage, le fait que les locaux du S.H.I.T. soient un ancien hôpital psychiatrique désaffecté n’est pas anodin. Ce lieu est en effet le lieu par excellence de l’exclusion par la société de celleux qu’elle décrète « anormaux ». En réinvestissant un tel lieu, les exclu-e-s du système scolaire revendiquent ainsi en quelque sorte leur non-conformité aux normes scolaires comme une force. Le discours normatif du pouvoir est ainsi retourné contre ce pouvoir lui-même, et l’« anormalité » devient ainsi une caractéristique unificatrice, un point commun qui rassemble tou-te-s ces exclu-e-s en une classe politique.
Contre un système scolaire basé sur la sélection (et donc l’exclusion) des individus, et par là producteur de hiérarchie et de ségrégation sociale, Bartleby propose une université qui accepterait tout le monde, parce que son but ne serait pas de trier les gens en dominant-e-s et dominé-e-s (ce que fait au passage à merveille notre système éducatif français) mais au contraire l’épanouissement de tous les individus, tou-te-s ensembles (et pas les un-e-s contre les autres).
Fraternités, élitisme et exclusion
Le film insiste bien sur cette opposition en faisant le parallèle entre l’université de Bartleby et celle, juste à côté, de Harmon. Les logiques de domination et d’exclusion à l’œuvre dans cette dernière sont clairement dénoncées dans toutes les scènes où Sherman essaie de se faire une place dans la fraternité. Déjà, avec leurs têtes d’aryens transpirant le mépris pour qui n’a pas leur capital (économique, social et culturel), les membres de la fraternité sont clairement ridiculisés par le film. A quoi s’ajoute que le point de vue sur ces pratiques est toujours celui de Sherman, qui en est la victime. Dans la persévérance de ce dernier à vouloir absolument s’intégrer à la fraternité, même au prix d’humiliations toutes aussi cruelles les unes que les autres, le film met en évidence la force de la pression sociale qui peut peser sur tou-te-s celleux qui sont exclu-e-s de ces cercles élitistes.
On pourrait penser que le fait de s’attarder longuement sur les fraternités relativise la force politique du film (qui ne s’attaquerait qu’à une dérive extrême de la logique de sélection/exclusion du système scolaire). Mais à mon avis, le film fait en même temps un parallèle clair entre ces pratiques élitistes et la logique plus générale du système scolaire. En effet, Sherman comme tou-te-s les étudiant-e-s du S.H.I.T ont ceci de commun qu’illes sont des exclu-e-s, des individus qui n’ont pas été accepté-e-s à l’intérieur d’un cercle de privilégiés parce qu’ils ne correspondaient pas à ses normes. Sherman finit d’ailleurs par rejoindre le projet de Bartleby (alors qu’il s’y opposait au départ), parce qu’il a pris conscience de l’injustice de cette logique de sélection/exclusion. C’est donc seulement après avoir vécu cette pratique du côté des dominé-e-s (et non plus de la place de dominant reçu au Harmon College qu’il avait au départ) que Sherman a pu se rendre compte de l’injustice du système auquel il participait.
En se concentrant sur les pratiques de la fraternité, et en opposant celles-ci au programme de l’université de Bartleby, le film me semble donc faire de l’idéologie des fraternités une sorte de quintessence de l’idéologie cimentant l’ensemble du système scolaire. Les fraternités ne sont pas juste une pratique extrémiste que l’on pourrait déconnecter du reste, mais elles s’insèrent au contraire parfaitement dans l’institution scolaire. On pourrait d’ailleurs dire exactement la même chose des pratiques de bizutage répandues dans l’enseignement supérieur français. Celles-ci ne sont pas des pratiques déviantes perpétrées par des individus particulièrement sadiques, mais bien au contraire la continuation de la logique à l’œuvre au sein même de l’école. En faisant sentir aux nouveaux et nouvelles venu-e-s qu’illes ne font pas encore parti de ce cercle privilégiés des dominants, de l’élite, les bizuteurs/teuses réaffirment de manière rituelle et plus ou moins violente qu’il existe un fossé entre celleux qui sont dedans (les « accepté-e-s ») et celleux qui n’y sont pas (les exclu-e-s).
La nécessité d’une alternative pédagogique
Accepted ne se contente pas de remettre en question cette logique de sélection/exclusion à la base de nos systèmes éducatifs, mais il s’attaque aussi à des questions pédagogiques de fond. Lorsque Bartleby se retrouve à devoir faire fonctionner la fausse université qu’il vient de mettre sur pieds, il va d’abord chercher des idées dans la prestigieuse université voisine. De son regard d’observateur extérieur, il se rend alors vite compte du gâchis humain que constitue ce « temple du savoir ».
Devant un amphithéâtre d’élèves luttant contre l’ennui et le sommeil, un professeur débite magistralement son cours.
Lorsque Bartleby tente d’adresser la parole à un autre étudiant, celui-ci le coupe nerveusement en lui disant : « Tais-toi ! ça va tomber à l’examen. Toute ma vie dépend de cette note ». La deuxième interaction de Bartleby avec un autochtone ne sera pas plus rassurante. Ce dernier se réveille en effet brutalement d’un demi-sommeil en hurlant « BAIIA ! Bénéfices avant impôts, intérêts et amortissement ». En quelques secondes, le film a parfaitement résumé ce que produit en masse notre système scolaire : ennui, désintérêt, stress, et abrutissement.
Partir des désirs des élèves
A cela, le S.H.I.T. opposera une pédagogie basée sur les désirs des individus. Pour déterminer le programme des enseignements, Bartleby commencera par faire un sondage auprès des étudiant-e-s pour leur demander ce qu’illes aimeraient apprendre. Or, intelligemment, le film commence par montrer les étudiant-e-s déconcertés par cette question. Et pour cause, s’il y a bien une question qu’on ne pose jamais aux élèves (ou alors très rarement, et dans un cadre toujours bien délimité et contraignant), c’est bien celle-là.



 « Qu’est-ce que tu veux apprendre ? » : la question « super-banco »
« Qu’est-ce que tu veux apprendre ? » : la question « super-banco »
Pour se rendre compte de la portée politique de la démarche de Bartleby, il importe à mon avis de bien avoir conscience des conséquences politiques du modèle auquel il s’oppose, à savoir celui basé sur la négation des désirs des élèves (comme l’est par exemple notre système éducatif). Que peut produire un tel système si ce n’est un rapport au savoir totalement désincarné, où les élèves ingurgitent des connaissances qui ne leur servent à rien sinon à avoir une bonne note ? Bien entendu, la quasi-totalité de ces connaissances sont oubliées dès qu’elles ont été recrachées pour l’examen. Il n’y a rien ici à reprocher aux élèves, car pourquoi s’encombreraient-illes de savoir dont illes n’ont aucune utilité ?
Si le système scolaire accable ainsi les élèves de savoirs inutiles, c’est donc sûrement pour un autre but que leur « épanouissement spirituel ». A mon avis, un premier but est de les trier en les jugeant sur des mêmes critères, critères déterminés arbitrairement et correspondant à la culture et aux compétences « légitimes » (que possèdent déjà celleux qui appartiennent au bon milieu social). Un autre but est sûrement d’habituer les élèves à accomplir un travail qui n’a pas de sens pour elleux, c’est-à-dire à obéir bêtement. Difficile de ne pas voir les applications politiques concrètes de cet apprentissage (qui ressemble fort à une « fabrique de l’impuissance », pour reprendre l’expression de Charlotte Nordmann[3]).
Les conséquences de cette pédagogie de l’obéissance et de l’abrutissement sont facilement constatables lorsqu’on observe les « sujets » que produit ce système scolaire, à savoir des « sujets » passifs, purement réceptifs, voire attentistes. Là encore, les élèves ne sont pas à blâmer puisqu’illes ont été précisément construit-e-s par l’école comme de tels « sujets ». Il n’y a qu’à comparer la différence entre un jeune enfant, curieux de tout ce qui l’entoure et avide de savoirs, et ce qu’il est devenu après des années de collège et de lycée (s’il va jusque-là), pour s’apercevoir tout ce qu’a pu produire notre chère école.
Au contraire, une pédagogie fondée sur les désirs des élèves ne peut qu’entretenir la curiosité et permettre la constitution d’une réflexion personnelle, d’un esprit critique, etc., c’est-à-dire de tout ce que l’école prétend viser tout en ne produisant en réalité que le strict opposé. Lorsque le doyen de l’université de Harmon accusera Bartleby d’être un criminel, celui-ci lui rétorquera : « Non, c’est vous le criminel, car si vous qui leur avez volé leur créativité et leur passion. Voilà le vrai crime. »
Pourquoi ne pas repenser totalement le système éducatif en l’ancrant dans les désirs des élèves ? Pourquoi ne pas partir des projets (professionnels, intellectuels, artistiques, etc.) des élèves ? Cela éviterait en tout cas de perdre un temps énorme à apprendre des choses inutiles (dans mon cas, je pense par exemple à la quasi-totalité des programmes de maths ou de physique que j’ai pu ingurgiter en 7 ans de collège-lycée). Pourquoi les individus ne se formeraient-illes pas en fonction de leurs besoins et de leurs désirs ? Un exemple de cette pédagogie dans le film est celui des skateurs qui, pour construire leur rampe, ont dû acquérir des compétences artisanales, ainsi que des compétences en « physique et aérodynamique » comme ils l’expliquent à la fin au juge.
C’est un tel rapport au savoir que propose Bartleby au S.H.I.T. Au lieu d’imposer un programme d’en haut, ce sont au contraire les étudiant-e-s qui élaborent elleux-mêmes ce programme, matérialisé par un immense mur sur lequel chacun-e écrit ce qu’ille souhaite apprendre.
De l’inutilité des professeurs
A la fin du film, lorsque le juge exigera de Bartleby qu’il lui donne la liste de ses enseignants (condition indispensable pour donner au S.H.I.T. le statut d’université aux yeux de l’Etat), l’ensemble des élèves présents dans la salle se lèvera, car comme l’expliquera Bartleby : « A South Harmon, les étudiants sont les profs ».
Aussi saugrenue qu’elle puisse paraître, cette idée selon laquelle les élèves peuvent être à elleux-mêmes leurs propres profs est néanmoins tout à fait intéressante d’un point de vue politique, et mérite donc d’être vraiment prise au sérieux. En effet, si le but de l’école est l’émancipation des individus par la conquête de leur autonomie, n’y a-t-il pas une contradiction assez gigantesque à les mettre dans une position de totale dépendance par rapport à un professeur ? Comment acquérir une quelconque autonomie lorsqu’on est placé dans une perpétuelle hétéronomie (au motif que « seul le prof peut transmettre le savoir car il est le seul à pouvoir l’expliquer », et « seul le prof peut être juge de la compréhension de l’élève ») ? Ne touche-t-on pas ici un des piliers de l’école comme « fabrique de l’impuissance » ?
Car il faut bien garder à l’esprit que c’est l’école elle-même qui a mis les enfants dans cette position de dépendance. C’est elle qui a créé l’hétéronomie là où il n’y avait qu’autonomie. L’argument principal avancé par les défenseurs de ce système éducatif est que seul le professeur, qui maîtrise l’ensemble du savoir qu’il va délivrer, est capable de savoir par quel chemin l’élève doit être amené pour passer de l’ignorance au savoir. Si l’élève a besoin d’un maître, nous dit-on, c’est parce que celui-ci est le seul à savoir comment passer progressivement du plus simple au plus complexe, sans brûler les étapes.
Mais la faiblesse de cet argument cache mal sa fonction politique de justification d’un rapport de domination. En effet, les enfants n’ont jamais eu besoin d’un maître pour apprendre quelque chose d’aussi complexe que leur langue maternelle. Parce qu’illes en avaient besoin, et par un apprentissage naturel fait d’essais et d’erreurs, illes ont réussi à la maîtriser malgré sa complexité. Ce n’est que lorsqu’illes sont arrivé à l’école qu’on leur a soudainement déclaré : « A partir de maintenant, vous ne pourrez plus apprendre tou-te-s seul-e-s. Sans un maître, vous êtes perdu-e-s ». Mais pourquoi ? Si je veux acquérir une connaissance, est-ce que je ne peux pas prendre un livre et apprendre tout-e seul-e ? Pourquoi aurais-je besoin d’un maître ? Pour me décomposer la difficulté en m’expliquant ce qui s’y trouve, en allant du plus simple au plus complexe ? N’ai-je pas la capacité d’y arriver tout-e seul-e ? [4]
L’idéologie qui affirme haut et fort la nécessité d’un maître détenteur du savoir repose donc sur une énorme mystification. Le cœur de cette mystification, c’est qu’il n’est pas seulement postulé que l’élève ignore ce qu’il veut apprendre, mais qu’il ignore comment apprendre. Or s’il existe effectivement des inégalités de savoir au sens où certaines personnes savent des choses que d’autres ne savent pas, il n’existe par contre aucune inégalité face au savoir au sens où il existerait des gens qui sauraient comment apprendre (les maîtres) et d’autres qui ne sauraient pas (les élèves). Car en ce domaine, tout le monde est savant, et personne n’a besoin de maître.
Il ne s’agit pas ici d’affirmer naïvement qu’il suffit de laisser les enfants se promener tou-te-s seul-e-s dans la nature pour qu’illes deviennent expert-e-s en toutes les matières. En ce sens, il ne s’agit pas nécessairement d’en finir avec toute forme d’encadrement des apprentissages. Mais il s’agit juste de substituer un type d’encadrement à un autre. Au lieu de « cadrer » les élèves en les enfermant justement dans des cadres sclérosants (c’est-à-dire en leur imposant de force des méthodes que l’on a forgées pour elleux), il vaudrait peut-être mieux se limiter à mettre à leur disposition les conditions pour un apprentissage autonome.
C’est ce que font par exemple les enseignant-e-s s’inspirant de la pédagogie Freinet. Celleux-ci ont entre autres pour principe d’intervenir le moins possible (comme disait Freinet lui-même : « plus je me tais, plus illes parlent »). Leur rôle se limite donc à encourager les élèves dans leurs projets et dans leurs démarches coopératives, ainsi qu’à mettre à leur disposition des outils leur permettant de se débrouiller tout-e-s seul-e-s. On trouve des exemples de tels « outils » dans les classes Freinet soumises aux contraintes du programme imposé par l’Education Nationale. Ces derniers peuvent prendre la forme de « fichiers » contenant la l’ensemble des connaissances à acquérir, et accompagnées d’exercices et de corrigés. Les élèves peuvent ainsi s’entraîner tout-e-s seul-e-s et s’auto-corriger, ce qui leur permet d’avoir une plus grande autonomie dans l’organisation de leur temps de travail (que chacun-e détermine soi-même dans ce qui est généralement nommé par les enseignant Freinet « plan de travail individualisé (PTI) »). Cette liberté laissée aux élèves a par ailleurs cet autre avantage qu’il produit une diversité de niveau au sein de la classe. Des élèves en difficulté sur un exercice peuvent alors demander de l’aide à d’autres qui maîtrisent déjà le savoir en question. Ce genre d’organisation favorise ainsi la coopération et la solidarité plutôt que l’habituelle compétition pour l’obtention de la meilleure note, et permet à celleux qui sont sollicité-e-s pour aider les autres de parvenir à une meilleure compréhension de ce qu’illes ont appris.
Si une telle autonomie dans l’apprentissage des savoirs peut exister (et existe effectivement malgré la marginalisation des enseignant-e-s Freinet par l’institution scolaire française) au sein d’un contexte aussi contraignant que l’Education nationale et ses programmes imposés, on imagine alors tout ce qui serait possible avec un peu plus de liberté. Car qu’est-ce que les livres (ou tout autre support de connaissance, comme internet par exemple), si ce n’est des outils permettant aux individus de construire elleux-mêmes leurs connaissances en fonction de leurs besoin et leurs désirs ?
En ce sens, les pistes de réflexions lancées par Ivan Illich dans Une société sans école me semblent elles aussi très précieuses. Comme l’indique le titre de son livre, Illich pense que l’école en tant qu’institution est néfaste à l’épanouissement des individus, et qu’il faudrait donc s’en débarrasser. De la même manière que nous sommes dépossédé-e-s de notre pouvoir politique par les institutions politiques, ou du pouvoir de nous guérir nous-mêmes par l’institution médicale[5], nous sommes dépossédé-e-s de notre pouvoir d’apprendre seul-e-s par l’institution scolaire. De la même manière que les politiques décident « pour notre bien » (mais à notre place) des lois ou des décisions politiques qui nous concernent, et de la même manière que les médecins décident « pour notre bien » (mais à notre place) des manières dont nous devons nous soigner, l’école décide « pour notre bien » (mais à notre place) de ce que nous devons apprendre et de comment nous devons l’apprendre. Comme si, à chaque fois, nous n’étions pas les plus à même de décider ce qui est bien pour nous.
Pour lutter contre cet asservissement à l’institution scolaire, Illich propose de la remplacer par des réseaux d’échange de savoirs. L’idée est juste de mettre à disposition de tout le monde des « objets éducatifs » (qui ne sont pas juste des supports de connaissances « théoriques » tels que les livres, ordinateurs, vidéos, etc. mais aussi tout objet au contact duquel un savoir peut s’acquérir par expérience, comme par exemple un garage, des outils et des pièces de voitures si l’on veut apprendre la mécanique), et d’« apparier » les gens pour qu’ils échangent ou construisent ensembles les savoirs dont illes ont besoin. Dans ce cadre, plus besoin « d’instructeurs » tels qu’ils existent dans l’institution scolaire, mais juste d’« éducateurs » qui n’ont pour rôle que de « faire se rencontre des partenaires égaux, bien assortis, de sorte qu’ensemble ils puissent apprendre ». Bref, on retombe ici sur le même genre d’idée que dans la pédagogie Freinet : les « instructeurs » qui déversent leur savoir dans la tête des élèves enferment ces derniers dans une dépendance qui tue leur autonomie. Le rôle des « éducateurs » doit donc se borner à créer les conditions matérielles d’un apprentissage autonome, encourager les élèves sur leur propre voie, ou encore aider les personnes d’intérêts communs à se rencontrer pour apprendre ensemble.
L’université de Bartleby n’est donc pas condamnée à rester un lieu d’ignorance parce qu’elle ne possèderait pas de corps enseignant. Bien au contraire, non seulement ses élèves apprendront autant qu’ailleurs (et même plus), mais illes entretiendront en plus un rapport autonome à l’apprentissage et aux savoirs. Là où le système scolaire classique favorise la dépendance face à une autorité détentrice du « Savoir » (dépendance dont on peut percevoir aisément les conséquences politiques), la pédagogie du S.H.I.T. produit au contraire des individus qui seront probablement beaucoup plus critique face au « Savoir » et à ses détenteurs auto-proclamés.
Des impensés plus que regrettables…
Cela dit, Accepted est loin d’être parfait. Un des enseignements dispensés au S.H.I.T. consiste par exemple pour quelques étudiants masculins (et au passage pour le spectateur masculin) à « étudier » le corps dénudé de filles pulpeuses en bikinis. A côté de cela, les créations artistiques du Noir de l’équipe consistent en des statuettes de Noirs au pénis démesuré et en érection (voilà selon le film ce qui sort de l’esprit d’un Noir lorsque celui-ci écoute sa « nature profonde »…). A quoi s’ajoute que le projet de Bartleby est aussi un moyen pour lui de gagner le cœur de la fille qu’il aime, ce qu’il obtiendra effectivement comme récompense à la fin du film.
Tout aussi dérangeant est le fait que le personnage de Bartleby soit le moteur quasi-exclusif de l’histoire. Parce qu’il trouve le plus souvent les idées qui permettent d’avancer et brille toujours par sa maîtrise de l’art du discours, Bartleby s’impose logiquement comme le leader naturel du projet S.H.I.T. Ce schéma ultra-individualiste est certes loin de ne concerner que ce film, puisqu’on le retrouve dans la quasi-totalité des films qui sortent sur nos écrans, mais il est néanmoins particulièrement regrettable ici. En effet, Accepted raconte l’histoire d’un projet d’école alternative fondamentalement égalitaire et anti-hiérarchique. Faire d’un individu exceptionnel le centre et le moteur du film est donc en totale contradiction avec le propos politique que tient par ailleurs le film sur l’école.
En finir avec une certaine école
Néanmoins, si l’on parvient à passer outre tout ce sexisme, ce racisme et cet individualisme, il reste dans Accepted une charge politique assez jouissive contre l’école traditionnelle, et surtout pour une nouvelle école. Car encore une fois, un film qui pose ainsi les bases d’une alternative radicale au système scolaire actuel, ça ne court pas les rues (d’ailleurs, si quelqu’un-e en connaît d’autres, je suis preneur).
Notre école (en France celle de notre vénérée Education Nationale) ne produit à mon avis principalement que de l’ennui, du stress, de l’impuissance et de l’abrutissement. Elle rend les élèves passifs, hétéronomes et soumis à l’autorité. Elle tue leur curiosité et leur créativité, encourage la compétition plus que la coopération et la solidarité, légitime les inégalités sociales et contribue ainsi à leur reproduction.
Logiquement, cette école n’a quasiment que des défenseurs du côté des dominant-e-s (intérêts politiques obligent). Un film comme Accepted est donc précieux, beaucoup plus à mon avis que tous les films prétendument « lucides » qui ne font que se complaire dans la réaffirmation du statu quo sans être capables d’imaginer autre chose.
Paul Rigouste
Idées de lecture
– Charlotte Nordmann, La Fabrique de l’impuissance 2 : L’école, entre domination et émancipation
– Jacques Rancière, Le Maître ignorant
– Ivan Illich, Une société sans école
– Anne Querrien, L’école mutuelle : une pédagogie trop efficace ?
– Alexandre S. Neill, Les libres enfants de Summerhill
– Célestin Freinet, Œuvres pédagogiques
(sur Célestin Freinet, je conseille aussi le très beau film de Jean-Paul Le Chanois, L’école buissonnière, de 1949)
[1] http://www.dailymotion.com/video/xcw69v_l-ecole-freinet-de-mons-en-baroeul_news#.UTvQWVf4XTo
[2] http://www.atd-quartmonde.fr/A-Mons-en-Baroeul-Nord-une.html
[3] Titre de son excellent livre publié aux Editions Amsterdam : La Fabrique de l’impuissance 2 : L’école, entre domination et émancipation.
[4] Toutes ces idées sont développées par Jacques Rancière dans son livre Le maître ignorant.
[5] Il me semble qu’Illich fait ainsi un parallèle entre toutes les institutions productrices d’hétéronomie pour toutes les critiquer, mais je ne sais plus où (si je ne l’ai pas carrément fabulé, ma mémoire n’étant pas d’une fiabilité absolue, loin de là…)
























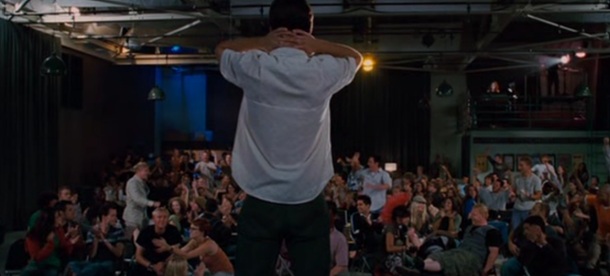







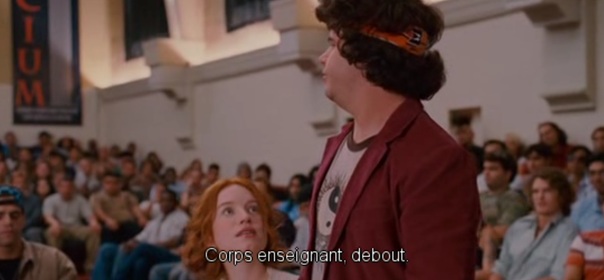



Commentaires récents